Voilà un prix Nobel qui, en France en tout cas, était très attendu. Quatre décennies après avoir mis en évidence l’une des plus étranges propriétés du monde qui nous entoure, le physicien Alain Aspect décroche enfin le prix Nobel de physique, au côté de l’Américain John Clauser et de l’Autrichien Anton Zeilinger. De l’avis général, il lui était promis de longue date. « Si John Bell n’était pas décédé prématurément en 1990, ils l’auraient eu ensemble il y a vingt ans », estime le physicien et philosophe Alexeï Grinbaum (CEA). Le temps a passé, et aux côtés des pionniers de la découverte de l’intrication quantique (Clauser, Aspect), le comité Nobel a choisi d’honorer un pionnier de son implémentation dans des technologies concrètes, aussi étonnantes et prometteuses que l’informatique ou la communication quantiques (Zeilinger).

« Ce prix Nobel récompense à la fois des travaux de physique fondamentale, menés il y a longtemps pour répondre à une question profonde, et des recherches plus récentes qui ont permis de les transformer en applications. Il illustre bien le fait que la recherche et ses résultats ne peuvent s’apprécier que sur le temps long », juge Serge Haroche, prix Nobel de physique 2012 . La « deuxième révolution quantique » que nous sommes en train de vivre plonge en effet ses racines dans les années 1980. Et même au-delà, dans les années 1960. Et au-delà encore, à l’année 1935...
Albert Einstein, 1935
Pour comprendre vraiment l’importance du prix Nobel décerné ce 4 octobre 2022, il faut en effet remonter à un célèbre article d’Albert Einstein. Cette année-là, avec Boris Podolsky et Nathan Rosen, le génial physicien propose une expérience de pensée qu’il voit comme une objection définitive à la mécanique quantique, contre laquelle il bataille depuis des années. Si l’on en croit les règles de la théorie de Niels Bohr et consorts, explique-t-il en substance, deux photons peuvent, sous certaines conditions, se comporter comme un seul système physique. Autrement dit, toute action sur l’un doit avoir instantanément des conséquences sur l’autre, et ce, quelle que soit la distance qui les sépare ! Pour Einstein, cette intrication est évidemment absurde. Pour qu’un photon réagisse en fonction de l’autre, il faut forcément qu’une information passe entre les deux. Et comme la théorie ne le prévoit pas, c’est qu’elle est en fausse. Ou au moins, incomplète…

La percée de John Bell
Les années passent et lorsque Einstein meurt en 1955, plus personne ne se soucie guère de cette objection fondamentale. Après tout, la physique quantique fonctionne. Depuis les années 1920, elle a permis des progrès spectaculaires dans notre maîtrise de la matière et de la lumière. Une révolution ! Alors peu importe si elle semble quelque peu magique...
Disponible sur notre boutique web et en kiosque (où nous trouver ?)

En 1964 cependant, un jeune physicien nord-irlandais du nom de John Bell remet la question sur le tapis. Dans une revue de second rang — car s’intéresser à ce sujet n’est pas vraiment bien vu à l’époque —, il expose le principe d’une nouvelle expérience qui doit enfin permettre de trancher entre Einstein et Bohr. Sur le papier, elle est assez simple : c’est une sorte de jeu de logique dans laquelle la probabilité de gagner ne peut jamais dépasser 75 %, sauf si l’intrication quantique entre en piste. Mais dans les faits, elle est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Hors de portée en tout cas de la technologie de l’époque.
Le temps des expériences
C’est en 1972 que John Clauser et Stuart Freedman (décédé en 2012) parviennent pour la première fois à mettre au point une expérience de Bell, ou plutôt une variante. « Cette expérience semblait confirmer la réalité de l’intrication quantique, mais elle ne permettait pas d’être certain qu’aucune information ne s’était échangée entre les photons intriqués », explique Nicolas Brunner, professeur associé au département de physique appliquée de l’université de Genève.

Alain Aspect, en 1982 à Orsay, réalise l’expérience de Bell qui apporte la preuve quasi définitive, confirmée et reconfirmée depuis, de la réalité de l’intrication. « Elle reste aujourd’hui l’un des aspects les plus étranges et les plus mystérieux de la physique quantique », souligne le physicien suisse.
Une révolution en marche
Mais l’intrication quantique est aussi devenue un outil. Sous l’impulsion notable d’Anton Zeilinger, à qui l’on doit de nouveaux tests fondamentaux de cette propriété, mais aussi sa première utilisation pratique (en cryptographie, ou comme base de nouveaux protocoles de communication), elle est le moteur d’une nouvelle révolution technologique. « Le domaine de l’information quantique est en pleine expansion », confirme Alexeï Grinbaum.
Pour lui, c’est d’ailleurs aussi un changement de paradigme que couronne ce Nobel : « S’il y a vingt ans, les physiciens qui travaillaient sur la communication quantique, la cryptographie ou l’informatique quantiques étaient souvent regardés de haut, ce n’est plus le cas ! » se félicite-t-il. Des réseaux de communication quantique se mettent en place à travers l’Europe. Des protocoles de cryptographie inviolables ont été testés en orbite par la Chine (grâce à Jian-Wei Pan, ancien élève de Zeilinger à Vienne). Et plus généralement « une énorme compétition est lancée à travers le monde sur les technologies quantiques », souligne Serge Haroche.
Bohr avait donc raison, mais en révélant un aspect fondamental de la physique quantique, Einstein n’avait pas tort ! Alain Aspect, John Clauser et Anton Zeilinger, eux, recevront leur prix Nobel à Stockholm le 10 décembre 2022.
À découvrir également :
-
La Chine développe la cryptographie quantique par satellite
-
Une équipe italienne envisage une flottille de 1000 satellites pour sonder la structure quantique de l’espace-temps
-
Podcast : 31 mars 1922, Einstein à Paris
-
La théorie d’Einstein une nouvelle fois validée, grâce à l’expérience Microscope
-
Podcast : Nouveau succès pour la théorie d'Einstein grâce au Pulsar Double

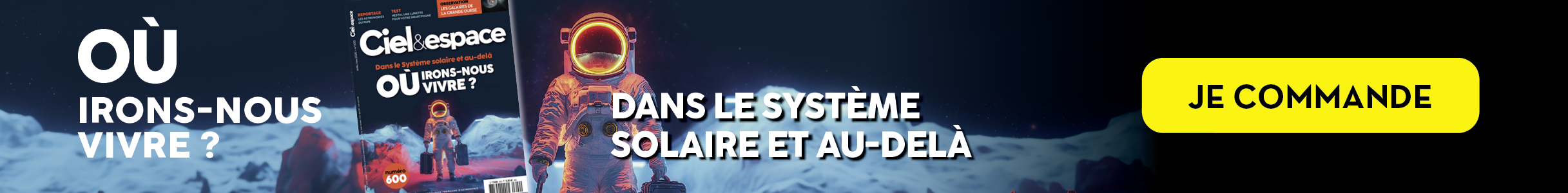
-67ea.jpeg)



