Étudier Trinity, essai nucléaire réalisé en juillet 1945 par l’armée américaine avant le lâcher des bombes d’Hiroshima et de Nagasaki, pour mieux comprendre la Lune ? Une idée surprenante, qui a pourtant permis à une équipe franco-américaine de confirmer l’hypothèse selon laquelle notre satellite serait né d’un impact géant entre la jeune Terre et un corps de la taille de Mars nommé Théia.
La chaleur de l’explosion de Trinity est montée à plus de 8000°C, vitrifiant le sable du désert Jornada del Muerto (Nouveau-Mexique). Les roches ainsi créées sont appelées trinitites. Leur analyse a montré qu’elles n’avaient pas toutes la même composition chimique. Plus le sable était proche du centre de l’explosion, plus il a subi une température élevée, et plus la trinitite qui en est issue est pauvre en éléments volatils.

Non seulement l’évaporation affecte différemment les éléments chimiques, mais également les formes diverses que peut prendre un même élément chimique, appelées isotopes, qui ne varient que par leur masse. Plus un isotope est lourd, plus il met longtemps à s’évaporer, et plus on le retrouve dans le caillou qui a été soumis à de fortes températures.
Des éléments qui manquent à l’appel, une particularité lunaire
Un phénomène qui a permis à l’équipe de Frédéric Moyrier de répondre à une énigme née de l’analyse des échantillons rapportés par les missions Apollo. Les basaltes lunaires sont en tout point semblables aux basaltes terrestres — ce qui semble normal si la Lune et la Terre se sont formées à partir du même matériaux, un mélange entre Théia et la prototerre —, sauf à un détail près : « Un net déficit en éléments volatils, qui restait inexpliqué », indique le géochimiste.
Dans une étude précédente, Frédéric Moyrier avait ainsi montré que les roches lunaires étaient appauvrie en isotopes légers du zinc. « C’était complètement nouveau et ne pouvait s’expliquer que par un phénomène d’évaporation. On avait devant les yeux un argument de plus que la particularité chimique de la Lune était due à un impact géant », s’enthousiasme le chercheur.
L’impact géant simulé par une bombe
Pour confirmer son résultat, l’équipe de Frédéric Moyrier souhaitait déterminer la proportion d’isotopes légers qui s’évaporerait lors d’une telle collision planétaire. Mais comment reproduire en laboratoire les conditions extrêmes d’un impact géant ? Impossible… « Un collègue américain m’a alors proposé d’étudier les trinitites », raconte le chercheur.

Et les résultats sont là : en analysant la composition de trinitites à 300, 150 et 50 m de l’explosion, les chercheurs ont réussi à contraindre ce rapport entre isotopes qui explique les données lunaires. Cela leur a permis de confirmer que la particularité chimique de la Lune est bien due à un phénomène d’évaporation, suite à un impact géant.
Les résultats de Frédéric Moynier confortent donc la théorie la plus répandue pour expliquer la formation de notre satellite et qui avait été remise en question en ce début d’année 2017.

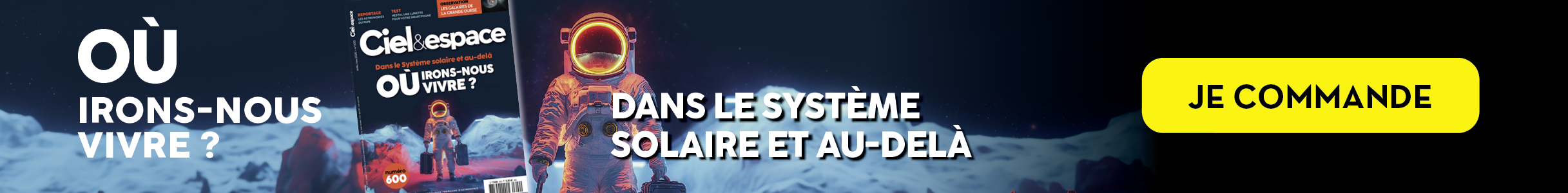
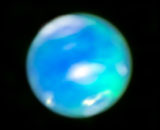
-67ea.jpeg)



Commentaires